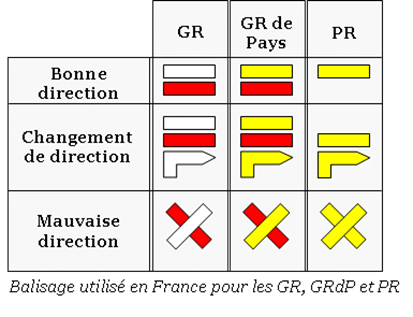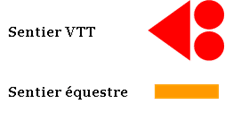La marche nordique … Oui mais c’est quoi ?
L’origine
La création de la marche nordique remonte aux années 1920. Durant la décennie suivante, elle est principalement pratiquée en Finlande. Les skieurs de fond finlandais s’en servent comme mode d’entrainement hors saison lorsqu’il n’y a pas de neige.
Les précurseurs finlandais de la discipline sont Leena Jääskeläinen et Mauri Repo. La première, enseignante à la Faculté d’éducation physique de l’Université de Jyväskylä à Helsinki, introduit en 1966 des sessions de marche nordique dans ses cours et vante ses mérites par rapport à la marche classique. Le second, professeur de ski finlandais, publie Hiihdon lajiosa en 1979 qui contient des méthodes d’entrainement hors saison pour le ski de fond proches de la marche nordique moderne.
En 1997, Marko Kantaneva, professeur de sport finlandais, publie son livre Sauvakävely sur une méthode de marche avec bâtons ainsi que des exercices de préparation physique1,3. Durant la même année, pour pallier le manque de neige, la fédération finlandaise de ski organise la première compétition de marche nordique.
La discipline connaît une importante expansion dans le pays et en 2000, on dénombre un million de pratiquants, soit une personne sur six. La même année, en Finlande, Aki Karihtala fonde l’International Nordic Walking Association (INWA), une organisation internationale qui a pour vocation de promouvoir et développer la pratique de la marche nordique.
Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant.
On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue. La dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès les premières foulées car la technique est simple.
Mais le saviez-vous ?
La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire de la marche nordique. Elle en définit les normes. Elle collabore avec la FFRandonnée pour développer l’activité en France.

Déroulement d’une séance :
Moins longue qu’une randonnée classique, la marche nordique se déroule sous la forme d’une séance de 1 heure 30 à 2 heures.
Chaque séance est découpée de la même façon :
- Échauffement musculaire et articulaire (10 minutes)
- Mise en route progressive et marche nordique à proprement parler avec quelques exercices de renforcement musculaire (1 heure – 1 heure 30)
- Étirements et récupération (10-15 minutes)
Les exercices d’échauffements
Les avantages de cette discipline :
- Une sollicitation de tous les muscles du corps : grâce aux bâtons, les parties supérieures (bras, pectoraux, abdominaux, …) et inférieures (cuisses, mollets, …) sont sollicitées.
- Une meilleure respiration et oxygénation de l’organisme : +60% par rapport à la marche normale.
- Un allié dans une démarche d’amincissement : les graisses sont brûlées de manière plus importante.
- Une fortification des os provoquée par les vibrations.
Equipements
Les bâtons
Compositions
Ils mélangent de la fibres de verre et du carbone. Certains sont aussi en aluminium ou mélangé avec du carbone.
Ils se doivent d’être : mono brin solides, souples et confortables.
La longueur des bâtons ou comment choisir ses batons
Elle dépend de la stature du marcheur.
La taille, ou la longueur des bâtons de marche est primordiale. Trop grand, vous vous fatiguerez les épaules au risque de vous blesser et n’aurez pas toute l’efficacité escomptée en phase de propulsion. Trop petit, vous ne pourrez apporter de la force lors de la traction. Vous serez même obligé de vous courber pour prendre appui dessus.
La règle est assez simple, lors du planté, votre bras doit avoir un angle à 90°.
Finalement vous appliquez ce ratio: votre taille x 0,68 à 0,70.
exemple : Pour une taille d’1m70 vous prendrez des bâtons de 115 cm => 170×0,68 = 115,6 cm.
On peut également évaluer la hauteur de façon plus approximative : votre taille – 50 cm.
En pratique, le marcheur débutant choisira des bâtons qui lui arrivent un peu au dessous du coude quand le bras est replié. Le marcheur plus sportif choisira une longueur un peu au dessus pour gagner en vitesse.
Les embouts

Ils diffèrent en fonction du sol où l’on pratique (terre, sol dur, gazon, …).
Ces derniers sont à choisir en fonction de la marque et le modèle de ses bâtons.
La dragonne ou gantelet

Elle est primordiale dans le sens où elle permet d’ouvrir la main pour prolonger la poussée et lui donner toute son efficacité. La maîtrise du bâton s’en trouve facilitée.
Les chaussures
Elles sont à choisir en fonction du terrain : baskets running, chaussures de randonnée à tige basse, chaussures de raid, etc.
Comment se pratique la marche nordique ?
Le mouvement de la marche nordique reprend celui de la marche ordinaire, dont l’amplitude est augmentée pour gagner en vitesse. Le marcheur marche le dos bien droit, en regardant loin devant lui, afin d’ouvrir sa cage thoracique et d’améliorer sa respiration.
De façon générale, le marcheur plante ses bâtons tour à tour entre les deux pieds, au milieu de son pas. L’inclinaison des bâtons par rapport au sol facilite la propulsion.
Lorsqu’il plante son bâton, le marcheur sert fortement la poignée pour assurer un bon contrôle de l’impulsion. Après l’impulsion, le marcheur lâche la poignée du bâton en ouvrant la main vers l’intérieur. Le bras peut ainsi parcourir toute l’amplitude de son balancier, sans casser le poignet.
Comment franchir un obstacle en marche nordique ?
Plus de contenu sont disponibles sur le site internet, partenaire de formations, soutenu par la fédération.